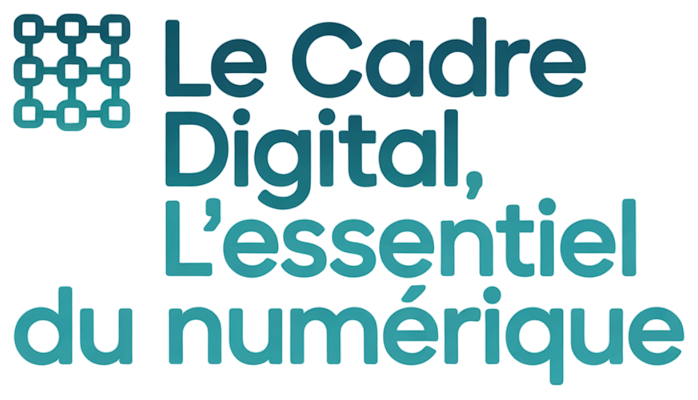Droit à l’information : transparence avant tout
La première clé du RGPD, c’est de ne plus laisser les personnes dans l’ignorance : toute entité collectant des données doit expliquer, en termes clairs, ce qui est collecté, pourquoi, pour combien de temps, et à qui les données sont transférées. Cette information doit être « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible » (Article 12 RGPD).
- Exemple concret : Affichage d’une politique de confidentialité détaillée sur chaque site ou application qui recueille (ou traite) des données personnelles.
- Nouveauté RGPD : Obligation d’informer aussi en cas de collecte indirecte (données obtenues auprès d’un tiers, pas directement auprès de l’utilisateur).
- Sanctions fréquentes : Fin 2023, la CNIL a sanctionné plusieurs sites pour des informations “non accessibles ou incomplètes” (CNIL).
Droit d’accès : consulter facilement ses données
C’est un droit fondamental. Tout utilisateur peut demander : “Quelles sont les données que vous détenez sur moi ?”. L’organisme doit répondre sous un mois, fournir une copie, détailler les finalités du traitement, les destinataires, la durée de conservation, etc.
- Exemple concret : Demander à une enseigne où l’on a un compte client de recevoir la liste de toutes les informations enregistrées (historique d’achats, identifiants, préférences…).
- Délai et coût : Sous 1 mois, sans frais (des frais “raisonnables” ne sont possibles qu’en cas de demandes manifestement infondées ou excessives).
Droit de rectification : corriger sans délai
L’utilisateur peut exiger la correction de toute information inexacte ou obsolète le concernant. L’organisme doit rectifier “dans les meilleurs délais”. Exemple classique : modification d’une adresse, d’une faute dans le nom, d’une donnée de santé inexacte.
Droit à l’effacement (“droit à l’oubli”)
Amorcé par la CJUE en 2014 contre Google, ce droit a été gravé dans le RGPD. Il permet de demander la suppression de ses données dans certains cas :
- Données qui ne sont plus nécessaires
- Retrait du consentement (pour des opérations où il était requis)
- Opposition au traitement ou traitement illicite
- Obligation légale de suppression
Il ne s’applique pas dans tous les cas (notamment si la loi exige la conservation, ou pour la liberté d’expression). Ce droit a été invoqué plus de 276 000 fois auprès de Google entre 2014 et 2023 (Google Transparency Report).
Droit à la limitation du traitement
Entre l’effacement total et l’usage libre, il y a une voie médiane : l’utilisateur peut exiger “la mise en pause” du traitement, par exemple le temps de contester l’exactitude de données, ou encore pour limiter l’utilisation à l’archivage.
- Cas fréquents : Les situations où une suppression serait trop brutale (litige, contestation…)
Droit à la portabilité des données : récupérer et transférer
C’est l’un des droits les plus novateurs. Tout utilisateur peut recevoir ses données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et les transmettre à un autre organisme si souhaité. Cela s’applique aux données fournies sur la base du consentement ou du contrat.
- Applications pratiques : Récupérer son carnet d’adresses pour le transférer d’une messagerie à une autre, ou exporter son historique bancaire vers une nouvelle banque en ligne.
- Obligation pour les plateformes : Les “fichiers clients” et historiques de commandes sont concernés.
Droit d’opposition : dire non à certains traitements
L’utilisateur peut s’opposer à tout moment au traitement de ses données pour des raisons tenant à sa situation particulière ; il peut aussi refuser l’usage de ses données à des fins de prospection commerciale (publicité ciblée, newsletters…).
- Chaque email de prospection doit proposer un lien de désinscription simple (exigé par le RGPD + la loi française)
- La CNIL a infligé 1,2 million d’euros d’amende à Carrefour en 2020, notamment pour non-respect du droit d’opposition (CNIL).
Droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée
Avec l’essor des algorithmes, il est crucial que l’utilisateur puisse refuser qu’une décision le concernant soit prise uniquement sur la base d’un traitement automatisé (profilage, scoring…). L’organisme doit offrir une intervention humaine et la possibilité d’exprimer son point de vue.
- Exemples : Refus d’un prêt bancaire généré automatiquement, recrutement via intelligence artificielle (Article 22 RGPD)