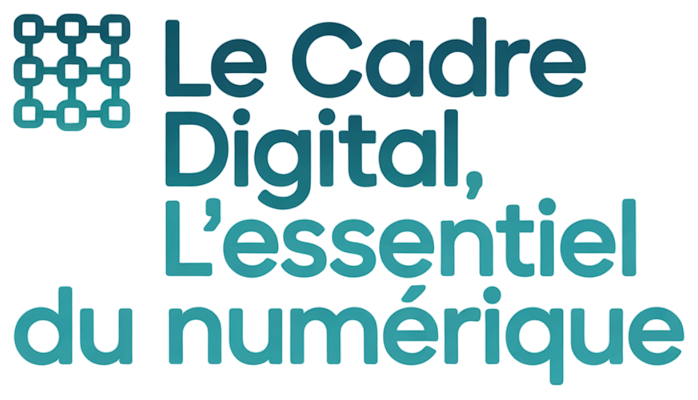2025 : Le Numérique Réinventé pour les Pros du Digital en France
L’intelligence artificielle, autrefois outil d’élite, s’est banalisée dans les entreprises françaises. Selon le rapport Capgemini 2024, 82 % des grandes entreprises françaises intègrent déjà au moins une solution IA à leurs process, contre 60 % en 2022. L’IA...